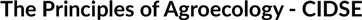3. La dimension économique de l’agroécologie
3.1 L’agroécologie promeut des réseaux de distribution courts et équitables au lieu de chaînes de distribution linéaires et crée un réseau de relations transparent (souvent invisible dans l’économie officielle) entre producteurs et consommateurs.
3.2 L’agroécologie aide essentiellement à fournir des moyens de subsistance aux familles paysannes et contribue à renforcer les marchés, les économies et les emplois locaux.
3.3 L’agroécologie est fondée sur une vision d’une économie sociale et solidaire.
3.4 L’agroécologie promeut la diversification des revenus agricoles permettant aux agriculteurs d’être plus indépendants financièrement, augmente la résilience en multipliant les sources de production et les moyens de subsistance, en encourageant l’indépendance par rapport aux intrants externes et en réduisant les mauvaises récoltes grâce à son système diversifié.
3.5 L’agroécologie accroît le pouvoir des marchés locaux en permettant aux producteurs de vendre leurs produits à des prix équitables et de répondre activement à la demande du marché local.
3.6 L’agroécologie réduit la dépendance par rapport aux aides (humanitaire, développement) et accroît l’autonomie de la communauté en encourageant les moyens de subsistance durables et la dignité.
Les impacts de cette dimension
Du fait qu’elle utilise les ressources locales et qu’elle fournit des denrées alimentaires aux marchés locaux et régionaux, l’agroécologie a la capacité de stimuler les économies locales et d’aider à éliminer les effets négatifs du libre-échange international sur les revenus des petits producteurs de denrées alimentaires.
Judith Hitchman, President & co-founder of Urgenci
Les pratiques agroécologiques sont économiquement viables étant donné que les méthodes de production agroécologique réduisent le coût des intrants externes et permettent ainsi aux producteurs d’être plus indépendants financièrement et techniquement plus autonomes. Grâce à la diversification de la production et de l’activité paysanne, les producteurs sont moins exposés aux risques du marché tels que la volatilité des prix ou les pertes dues aux événements météorologiques extrêmes, exacerbés par le réchauffement climatique. Ce sont en particulier les petits producteurs qui bénéficient de l’agroécologie, car ils peuvent augmenter durablement leurs rendements, leurs revenus ainsi que leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. En ce qui concerne la production et les revenus, l’agroécologie est en particulier bénéfique aux ménages moins aisés et on peut dire qu’elle est dès lors spécifiquement favorable aux personnes en situation de pauvreté. L’agroécologie aide également les économies en fournissant une technologie adaptée et des opportunités d’emplois dans l’alimentaire dans les zones rurales et périurbaines. Elle offre par ailleurs des moyens de subsistance aux habitants des villes possédant un petit terrain ou ayant accès à un terrain public. Un des objectifs de l’agroécologie est d’offrir un travail décent qui respecte les droits de l’homme et qui garantit un revenu décent aux producteurs. Vu qu’elle réduit la distance entre producteur et consommateur, l’agroécologie réduit les coûts de stockage, de réfrigération et de transport ainsi que les pertes et les déchets alimentaires. L’agroécologie tient pleinement compte des externalités sociales et environnementales car elle réduit la production de déchets et les effets sur la santé, et soutient les externalités positives telles que la santé écologique, la résilience et la régénération des écosystèmes.
Exemple 1 : l’agroécologie est bénéfique aux économies rurales
En 2016, Trócaire, en collaboration avec l’organisation partenaire locale Red K’uchubal, a organisé un appel à propositions de recherche dans le but d’évaluer les changements liés à l’alimentation et à la résilience chez les petits agriculteurs qui avaient adopté des pratiques agroécologiques au Guatemala occidental. Le Programme d’Etudes Rurales et Territoriales de l’Université de San Carlos au Guatemala a été de grande utilité à l’équipe qui a mené la recherche en 2016, ont été comparés les résultats obtenus entre un groupe de dix agriculteurs pratiquant l’agroécologie et un groupe de dix agriculteurs semi-conventionnels, sur la base d’une série de critères sociaux, économiques et environnementaux. Les conclusions de la recherche, achevées en 2017, sont présentées dans un rapport en espagnol (avec un résumé en anglais) et dans une vidéo également en espagnol avec sous-titrage en anglais.
En ce qui concerne la dimension économique de l’agroécologie, la recherche a révélé des différences statistiques importantes dans les revenus agricoles bruts. Les agriculteurs agroécologiques obtiennent des revenus agricoles plus élevés que l’autre groupe semi-conventionnel. En conséquence, les agriculteurs agroécologiques ont dit avoir généré assez de revenus pour vivre de leur terre au cours de l’année alors que les agriculteurs semi-conventionnels ont dit avoir besoin de compléter leurs revenus agricoles avec un emploi hors de la ferme. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats, parmi lesquels :
– l’obtention de rendements comparables à ceux obtenus de cultures telles que le maïs, mais sans recourir à des intrants chers, notamment les engrais chimiques, les pesticides et les herbicides,
– une meilleure intégration au marché local ainsi qu’une production plus variée,
– et une moindre dépendance par rapport à l’achat de denrées alimentaires pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels ; les dépenses alimentaires hebdomadaires des foyers agroécologiques ne représentent en moyenne que 47 % de celles des foyers conventionnels.
La video porte sur le développement des chaînes de production agroécologique et sur le rôle important des coopératives d’agriculteurs dans la commercialisation de différentes lignes de produits agroécologiques, et montre comment l’agroécologie procure aux agriculteurs des moyens de subsistance tout en contribuant aussi à renforcer les marchés locaux, les économies locales et l’emploi.
Sources/Informations supplémentaires
Praun, A., Calderón, C., Jerónimo, C., Reyna, J., Santos, I., León, R., Hogan, R., Córdova, JPP. (2017). Algunas evidencias de la perspectiva agroecológica como base para unos medios de vida resilientes en la sociedad campesina del occidente de Guatemala.
Exemple 2 : Comment une institution de microfinance a adapté des produits financiers aux effets environnementaux des pratiques agricoles
Développer et financer la transition et l’adaptation aux pratiques agroécologiques est un enjeu important pour beaucoup d’associations d’agriculteurs en Afrique de l’ouest. Les parties prenantes du programme PAIES, le CCFD et la SIDI (filiale du CCFD en microfinance), relèvent le défi au nom de leurs partenaires depuis 2014 en mettant en place ce programme (pour soutenir les agriculteurs qui se convertissent à l’agroécologie). La transition ne peut s’appuyer sur le seul soutien de l’ONG, elle doit aussi être intégrée dans des pratiques de microfinance et des produits dont disposent les agriculteurs.
Pour répondre aux problèmes qui se posent aux associations d’agriculteurs, l’UBTEC, une institution de microfinance (Caisse d’Épargne et Crédit), a analysé les pratiques agroécologiques de ses membres afin de développer des produits financiers avec un système Bonus/Malus (taux d’intérêt plus bas/élevé) en fonction de l’impact environnemental des pratiques agricoles.
A partir de cette étude a été réalisée une brochure sur les pratiques agricoles dans le nord du Burkina Faso dans laquelle est analysée la rentabilité de la production liée aux méthodes et pratiques appliquées (emploi d’intrants chimiques ou agroécologie), ainsi que des pratiques agricoles et non agricoles les plus durables (en prenant toujours en compte les dimensions écologique, sociale et économique de la durabilité). Cette brochure a aidé l’UBTEC à soutenir les pratiques durables via ses produits financiers actuels.
Il ressort de l’étude que certaines cultures pouvaient être plus rentables si les agriculteurs appliquaient une approche ou des méthodes agroécologiques telles que l’utilisation d’engrais organiques, de pesticides naturels (oignons, pommes de terre ou niébé), mais également que d’autres pouvaient être moins ou non rentables (tomates, piments ou choux). C’est un point important. Il faut trouver un équilibre entre la rentabilité et l’approche agroécologique qui respecte l’environnement et la santé des producteurs et des consommateurs. Au cours de la recherche, les caractéristiques des pratiques agroécologiques ont été définies afin de permettre la création d’un modèle qui introduise et privilégie ces pratiques agricoles. Les chercheurs ont par ailleurs analysé différents types d’investissements faits par les agriculteurs pour augmenter leurs rendements, les limites auxquelles les producteurs se sont heurtés et les stratégies visant à les diminuer. Ces différents éléments de la recherche ont permis à l’UBTEC de proposer des moyens de choisir les activités agricoles qui pourraient être financées, ainsi que des moyens concrets de soutenir les emprunteurs qui adopteraient l’agroécologie. Fin 2017, les résultats de la recherche et du partenariat ont débouché sur le lancement de nouveaux produits financiers (prêts agricoles saisonniers) soutenus par un fonds de garantie. L’UBTEC a ainsi commencé à prêter de l’argent à ses membres avec un taux d’intérêt variant selon les pratiques appliquées et leur impact environnemental : l’agroécologie à un taux plus bas, les pratiques non agroécologiques à un taux plus élevé. Dans les 4 mois à compter du lancement du prêt, 450 demandes de financement pour activités agroécologiques ont été reçues.
Sources/Informations supplémentaires
“Rapport de l’étude pour adapter les produits financiers de l’UBTEC avec un système de Bonus/Malus en fonction de l’impact environnemental des activités financées : Programme PAIES »
Video sur la recherche et comment celle-ci a été menée.