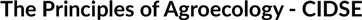Les principes de l’agroécologie
Vers des systèmes alimentaires socialement équitables, résilients et durables
CIDSE
Préface
Qu’entendons-nous par « agroécologie » ? À quoi ressemble-t-elle ? Peut-elle être appliquée à grande échelle ? Pouvons-nous donner des exemples concrets ? Comment pouvons-nous la soutenir ? Est-elle productive ? Existe-t-il des données prouvant qu’elle est efficace, qu’elle tient ses promesses ? Voici quelques questions souvent posées par des personnes qui connaissent peu le domaine de l’agroécologie alors que ceux qui le connaissent en soulèvent d’autres :
“Je ne pense pas qu’ils parlent réellement d’agroécologie ; l’agroécologie ne se limite pas à l’amélioration de la vie dans les sols, c’est bien plus que ça !”
“C’est invraisemblable, ils utilisent le mot agroécologie, mais ils l’ont totalement vidé de son sens original, on dirait qu’ils l’utilisent pour verdir le modèle industriel”
“ C’est peut-être la manière des scientifiques de voir l’agroécologie, mais les mouvements paysans la voient autrement”
“Il/elle n’utilise pas le concept d’agroécologie, mais ce dont il/elle parle est proche de notre manière de voir et de définir l’agroécologie”
Nous pourrions continuer indéfiniment. De manière générale, il est nécessaire de définir ce qu’est l’agroécologie et ce qu’elle n’est pas, dans le but d’obtenir un soutien politique, pour que la discipline puisse se développer, pour éviter la cooptation et lutter contre les fausses solutions, etc. Les mouvements sociaux, la société civile, les institutions internationales et les universitaires ont tenté à plusieurs reprises de définir l’agroécologie au cours des dernières années et nombreux sont ceux qui cherchent encore à le faire.
Dans notre réseau, nous avons ressenti le même besoin de clarification et d’alignement. Ce qui suit est le résultat initial de ce travail. Nous avons pris la décision de répartir les différents principes entre les quatre dimensions de la durabilité : environnementale, socioculturelle, économique et politique. Nous pensons que c’est une bonne façon de cerner la complexité et l’aspect multidimensionnel de l’agroécologie. Cela nous permet de comprendre les agro-écosystèmes agricoles et les systèmes alimentaires en prenant en compte les contextes social, économique et politique dans lesquels ils se trouvent. C’est aussi une manière de s’appuyer sur des catégories de principes déjà identifiées dans des travaux précédents rédigés par d’autres acteurs issus de mouvements engagés dans l’agroécologie.
Notre objectif est clair. Notre but n’est pas de créer une nouvelle définition de l’agroécologie, mais d’identifier des principes qui renforceront notre discours ainsi que notre plaidoyer et nos actions. Nous voulons approfondir une vision et une conception communes de l’agroécologie (que nous considérons comme l’un des leviers principaux pour atteindre la souveraineté alimentaire et la justice climatique) : que signifie-t-elle, à quoi ressemble-t-elle ?
C’est la première étape d’un processus plus vaste. Celui-ci comprendra également la conception d’un guide pratique qui, avec ces principes, devrait aider à instaurer un dialogue dans différentes régions du monde et au sein des organisations membres de notre réseau pour évaluer les pratiques et stratégies actuelles. Alors que nos sociétés font face à des crises sociales, environnementales et économiques profondes et que le changement climatique impose à nos sociétés des changements radicaux dans les modèles de production actuels, il est urgent que l’agroécologie soit comprise et largement soutenue. Par cette modeste contribution, nous espérons et pensons que nous pouvons contribuer à renforcer le mouvement social en faveur de l’agroécologie, ce qui est le but de nos activités dans ce domaine.
Prof. Michel Pimbert, Coventry University (UK)